Synopsis
Avec ce premier long métrage hypnotique, le réalisateur espagnol Mauro Herce reprend le principe du Léviathan de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel (2012), qui nous plongeait déjà dans les entrailles d’un immense chalutier. Différence majeure entre les deux, toutefois : ici la nourriture du bateau n’est pas composée de poissons mais par les hommes d’équipage eux-mêmes ! Fort de ses 200 heures tournées en deux mois et demi, le cinéaste s’abstient de tout commentaire et joue, en Méphistophélès wagnérien, des sons du navire pour nous ensorceler au fil d’un voyage où l’on finit par perdre toute notion d’espace, de temps, de géométrie (on ne parvient bientôt plus à distinguer si un plan est vertical ou horizontal). Il ne fuit pas la monotonie répétitive des jours, des nuits et des gestes, mais en tire au contraire une langueur engourdissante, sans sombrer pour autant dans l’ennui, nous conduisant à ressentir concrètement le sens du titre, expression désignant la vitesse la plus lente d’un navire (mot à mot : "lenteur mortelle pour avancer")... Il construit ainsi une oeuvre païenne et dantesque dans laquelle l’humain est au service d’un Moloch qu’il nourrit pour une avancée dont on ne sait même plus la destination ni le but. Chef opérateur de formation (dont Mimosas d’Oliver Laxe), Mauro Herce peint des tableaux quasi religieux, recourant au vert, au rouge et au jaune lors des nuits à bord, puis à un blanc onirique à chaque sortie de port, évoquant alors le meilleur de Whistler et Turner. Certains plans des cales évoquent des cathédrales de fer. Radars et écrans de commandement font penser à l’ordinateur Hal de 2001, l’odyssée de l’espace. Les arbres à transmission palpitent comme des artères, le moteur évoque un coeur. On essaie vainement de se raccrocher à ce que ça raconte de la vie à bord. Peine perdue ! La vague nous emporte, nous immerge. On assiste, impuissants, à l’avarie qui va inonder les stocks de blé qui finiront pour partie par-dessus bord, comme une dîme due à l’océan, et dont le reste sera refusé par le client à l’arrivée. Dans un sursaut, on se dit, en voyant les marins y enfourner leurs pelles et piétiner les grains de leurs bottes, que c’est ce même aliment qui finira en pain ou en plat dans nos assiettes ! Et quand ils se lancent dans un karaoké ou dans un slow lascif, expurgeant leur trop-plein de libido frustrée, ils apparaissent comme des ombres en survie. Quant à leurs conversations téléphoniques avec leurs proches - quand il y a du réseau, ce qui est rare -, les difficultés de communication les rendent aussi tragiques que des suppliques aux dieux avant leur colère. Le plus curieux, c’est de constater in fine qu’on aura peut-être vu une dizaine de marins tout au plus pour manoeuvrer, entretenir et guider ce monstre des enfers auquel ils sont enchaînés. Alors que la caméra replonge une dernière fois dans le ventre vibrant de ce Metropolis des mers, on se dit que les hommes sont des robots et la machine bien vivante. Ironie : elle s’appelle Fair Lady ! Un film exigeant, qui impose que l’on prenne le temps de s’y abandonner.
© LES FICHES DU CINEMA 2016


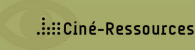
 Réalisateur
Réalisateur Scénariste
Scénariste Scénariste
Scénariste Société de production
Société de production Société de production
Société de production Producteur
Producteur Distributeur d'origine
Distributeur d'origine Mixeur
Mixeur Compositeur de la musique originale
Compositeur de la musique originale Monteur
Monteur